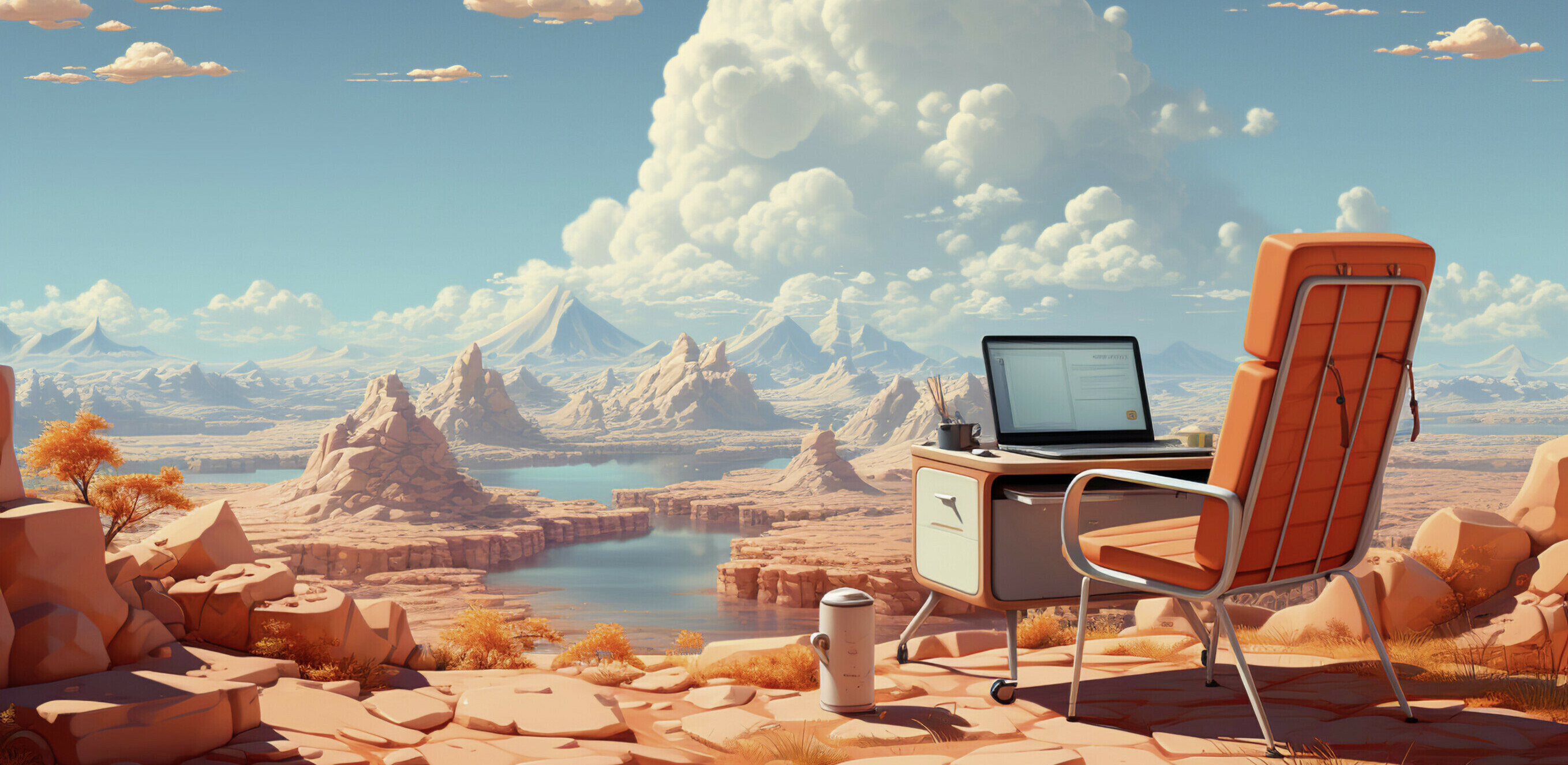L'échelle des décibels est logarithmique, on ne peut pas les additionner ni les soustraire. Trois décibels supplémentaires correspondent à un doublement du niveau sonore. © Adobe Stock
L'échelle des décibels est logarithmique, on ne peut pas les additionner ni les soustraire. Trois décibels supplémentaires correspondent à un doublement du niveau sonore. © Adobe Stock
Souvent négligée, l’acoustique a longtemps été le parent pauvre de l’aménagement des espaces de travail. À l’heure du retour au bureau, les entreprises ne pourront toutefois plus en faire l’économie. La qualité sonore des espaces est aussi devenue un enjeu d’attractivité et de bien-être pour les collaborateurs.
«L’espace efface le bruit », écrivait Victor Hugo. La citation du poète français pourrait paraître contre-intuitive pour tous ceux qui fréquentent les open spaces. Même si nous sommes aujourd’hui loin des espaces gargantuesques et des mètres linéaires de bureaux décloisonnés, à l’ambiance sonore de cathédrale, popularisés par les États-Unis...
Cet article est réservé aux
abonnés
Continuez votre lecture en créant votre compte et profitez de 5 articles gratuits
Pour lire tous les articles en illimité, abonnez-vous